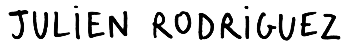Une histoire de la pensée urbaine
Françoise Choay, L’urbanisme, utopie et réalité, édition du seuil, Paris, 1965
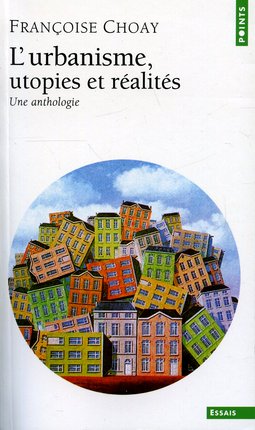
Le livre L’urbanisme, utopie et réalité de Françoise Choay présente un panorama de la pensée urbanistique entre le début du XIXe siècle jusqu’aux années 1960. Édité en 1965, il est l’un des premiers en France à tenter une réelle Histoire de l’urbanisme.
Il se compose de deux parties : Une synthèse rigoureuse écrite par F. Choay visant à dégager les différents courants de l’urbanisme (p.7 à 83) et une anthologie recueillant des extraits provenant d’ouvrage écrit par des penseurs de la ville, aussi bien urbanistes, écrivains ou philosophes (p.85 à 435). La démonstration suit un ordre chronologique pour affirmer la thèse que l’urbanisme du XXe siècle, considéré habituellement comme une révolution de la pensée de la ville, hérite en réalité de deux courants de pensées antérieurs d’un siècle, qui, malgré toute volonté de rupture, n’ont cessé d’être sous-tendus dans les théories urbanistiques.
La première partie propose un classement systémique de la pensée de la ville en regroupant les urbanistes en différents courants théoriques. F. Choay découpe tout d’abord son analyse en deux périodes : Les pré-urbanistes au XIXe siècle face aux préoccupations sociales de la révolution industrielle et les urbanistes au XXe dont le personnage charnière est Ebenezer Howard (1850-1928), l’inventeur de la cité jardin. Alors que le pré-urbanisme est « l’œuvre de généralistes (historiens, économistes ou politiques), [l’urbanisme] est sous ses deux formes, théorique et pratique, l’apanage de spécialistes, le plus généralement architecte (…) l’urbanisme est dépolitisé» (p.30). La grande différence entre les deux époques réside également dans la mise en application des théories. Les théories pré-urbanistes sont de l’ordre de l’utopie et ne génère que peu de réalisations concrètes malgré la demande en logement, ce qui n’est pas le cas de l’urbanisme qui trouve un terrain d’application dans la volonté politique de résoudre la crise du logement du XXe siècle générée par la révolution industrielle d’abord et par les ravages des deux guerres ensuite.
Deux courants antagonistes sont repérés à travers ces périodes : Le modèle progressiste d’une part, dont la pensée est tournée vers le progrès, la technique et l’hygiène physique, et le modèle culturaliste d’une autre, cherchant dans la forme des villes du passé l’organicité perdue. Chacun des modèles puise sa source dans la période pré-urbaniste (les premières théories apparaissent en 1810 pour les progressistes et 1840 pour les culturalistes) pour se concrétiser dans la période urbaniste. Des courants de pensées satellites apparaissent également. Pour la période du pré-urbanisme : la culture sans modèle issue de la pensée communiste et l’anti-urbanisme américain traduit par le refus de la ville industrielle; pour la période urbaniste : le naturalisme propose un habitat dispersé mais couvrant de très grandes surface : un village de la taille d’un pays. Une dernière partie de l’analyse est consacrée à la critique de l’urbanisme dans les années 1950-1960 au travers des théories de la technotopia (la technique toute puissante libérant la ville de sa contingence et de son entropie) et de l’anthropopolis (l’homme au centre des préoccupations urbanistiques, l’hygiène morale plus importante que l’hygiène physique). Ces deux critiques de l’urbanisme gardent néanmoins les grandes directions respectives du progressisme et du culturalisme.
L’anthologie reprend le plan du système mis en place dans la première partie et regroupe des extraits écrits par les urbanistes selon les courants de pensée énoncés précédemment. Ceux-ci, provenant parfois de livres différents, sont ensuite regroupés selon les thèmes débattus (des titres intermédiaires sont donnés par F. Choay), formant un ensemble visant à dégager la pensée maîtresse de l’auteur. Cette organisation rend possible une lecture non linéaire, où il devient aisé de piocher une information précise sur un courant ou un urbaniste particulier. Cette partie, mise en parallèle avec la synthèse, la complète et l’approfondit. Elle permet également de la re-questionner : des auteurs regroupés dans une même catégorie pouvant diverger sur certaines idées.
Le livre est conduit de façon à montrer en parallèle l’importance du pré-urbanisme et de l’urbanisme : « Ils ont exercé une influence corrosive sur les structures urbaines établies, ils ont contribué à définir et mettre en place certaines normes urbaines de base » (p.73), et de la nécessité de dépasser cet ordre des choses : « malgré la prétention des théoriciens, l’aménagement des villes n’est pas l’objet d’une science rigoureuse. (…) Ces motivations se sont objectivés dans des modèles ou type idéaux d’agglomération urbaine. (…) Le modèle ouvre forcément sur l’arbitraire » (p.74-75).
Même si F. Choay tend à garder un regard objectif, on sent se dessiner un certain malaise, un doute qu’elle émet sur les théories de l’urbanisme de l’époque et qui se retrouve par exemple dans la philosophie d’Heidegger. Aux théories progressistes elle répond : « Ainsi la nouvelle ville devient en même temps que le lieu de la production la plus efficace, une sorte de centre d’élevage humain à l’horizon duquel se profile , menaçante, l’image analytique du père castrateur de ses enfants » (p.41). Le modèle progressiste, le seul qui semble réellement prendre comme support la réalité urbaine des villes industrielles, oublie qu’habiter ne se résume pas à un rapport d’utilisation. Ce doute, cette « crise du fonctionnalisme » (p.77) est caractéristique de ces années charnières dans la pensée de l’architecture et de la ville. « Les créateurs de l’industrial design s’étaient en effet laissés obnubiler par la fonction d’usage des objets, par leur « ustensilité », en négligeant la valeur sémiologique » (p.77). Par cette phrase, F. Choay ne préfigure-t-elle pas les théories post-modernes qui animeront l’architecture et l’urbanisme dès les années 1970 ? Les critiques des applications de l’urbanisme dès les années 1950 et les contre-propositions sont-elles en rupture radicale avec la tradition de l’urbanisme du début du XXe siècle ? Ne sont-elles pas qu’une reprise sous un angle différent de mêmes idées issues d’un mouvement de pensée plus vaste et plus ancien ? Il y aurait alors nécessité de dépasser cet ordre des choses, cette dichotomie progressisme/culturalisme présente de façon sous-tendue depuis 150 ans. Ce dernier point apparaît entre les lignes de la conclusion et laisse le débat en suspens.
Le modèle urbain est un problème souvent mis en exergue par F. Choay. Presque toutes les théories de la ville depuis le XIXe siècle tentent de trouver une sorte de standard, une ville type, reproductible. Les critiques sans modèle tombent à l’inverse dans l’indéfinition.
Comme le remarque F. Choay, la ville est trop peu souvent pensée en terme de processus, de dynamique. Pourtant, si l’on regarde comment les villes arrivèrent à ce qu’elles sont aujourd’hui, on y découvre un entrelacs complexe, une succession de couche, mélange de causes sociales, politiques, historiques,… cette fameuse organicité dont désirent s’inspirer les urbanistes culturalistes. Ceux-ci commirent pourtant l’erreur de considérer uniquement la forme de la ville organique, et non le mouvement créateur de cette forme. Car on ne peut faire la copie d’une ville organique, elle est non reproductible autant qu’elle est unique. C’est son histoire, le temps qui l’a forgée, qui lui donne vie, lui donne sens. Vouloir l’ériger en modèle c’est l’arracher de sa temporalité – de son sens – bref la tuer. Si chaque urbaniste nous décris avec perfection le présent de la ville idéale, quid de son futur, de son évolution ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la ville est sans cesse en devenir. Elle doit satisfaire voire anticiper les besoins et modes de vie humains sans cesse changeant. Son essence – à la fois la condition et la raison de son existence – est de n’être jamais finie.